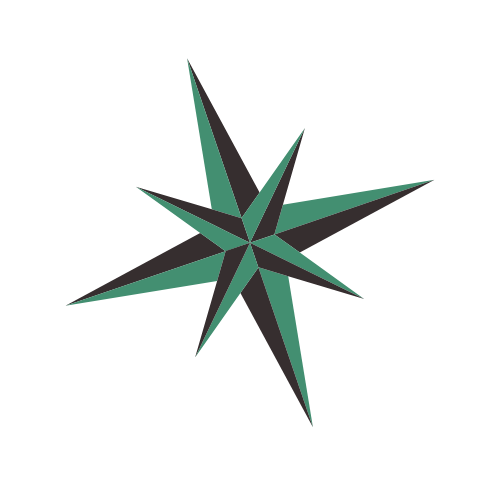Le Vexin, ancien comté
Naissance du Vexin
Premiers occupants
Les premiers habitants du Vexin, des Gaulois, s’étaient initialement installés sur le sol de Gisors avant de migrer progressivement vers la Seine. Pendant ce temps, les Waelsch-Gast, des colons belges, envahissent la région en remontant le fleuve, mais ils sont repoussés sur la rive nord par les Chartrains récemment établis à Mantes. Les colonisateurs prennent possession des territoires conquis, et en 350 avant Jésus-Christ, les Gaulois doivent faire face à une nouvelle tribu, appelée les Vellocasses.
Dès leur arrivée, ces derniers, avec des sociétés déjà développées, érigent des dolmens, déplacent des mégalithes et construisent des cavernes, servant ainsi de lieux de culte et de sanctuaires. Des travailleurs admirables, ils attirent l’attention de Jules César. Néanmoins, les Romains mettent fin à leur pouvoir dès l’an 57 avant Jésus-Christ. Avec 15 000 hommes, les Romains envahissent la région, pavent les routes boueuses et construisent des villas en retrait de leurs camps militaires. Progressivement, ils érigent des structures solides telles que des temples, des églises, des palais, des bains, des arènes et des aqueducs.
Après le passage de César, les guerres de religion se succèdent car les Romains cherchent à évangéliser les peuples conquis. Le Christianisme est finalement reconnu en 313, mais la paix est encore lointaine. Des tribus barbares, notamment les Francs, les Huns et les Visigoths, envahissent le territoire par la Seine, repoussant les Romains jusqu’aux Alpes en 476. À leur passage, les édifices romains sont saccagés et détruits. Les Francs, victorieux, réorganisent le territoire en comtés et duchés. Clovis, roi des Francs, se convertit au christianisme pour renforcer sa domination sur les peuples conquis, établissant sa cour à Lutèce, tandis que sa femme, St-Clothilde, soutient des fondations pieuses. L’ancienne administration militaire romaine passe ainsi aux mains des ecclésiastiques.
Abbayes, comtés et duchés
Par la force, son descendant Clotaire place le pays sous son autorité au début du 7ème siècle. Son fils, le roi Dagobert, accorde des terres à l’abbaye de St-Denis vers 630, tout en laissant à l’évêque de Rouen les terres de Beauvais.
À mesure que l’influence du clergé augmente, les seigneurs deviennent des alliés grâce à leurs dons. Les échanges de terres et de pouvoirs engendrent tensions et conflits. Pour remercier ses chefs d’armée qui défendent son duché de Neustrie, Charles Martel divise son territoire et le répartit entre ses fidèles. Le comté du Vexin est ainsi confié à un certain Wittram en 725, avec des frontières délimitées par la Seine, l’Andelle, l’Epte, le Sausseron et l’Oise, entouré par les comtés de Pontoise, Meulan, Chaumont, et Gisors-Andelys, qui forment la Neustrie.
Le fils de Martel, Pépin le Bref, ambitionne de devenir roi de France, ce qu’il réalise en 752. Peu après, le territoire fait face à de nouvelles invasions scandinaves et danoises. Les Normands, venus piller la région, s’avancent en nombre, et le roi Charlemagne peine à les arrêter avant sa mort en 814. En 853, son successeur Charles le Chauve organise la défense, mais les Normands envahissent jusqu’à Paris. Les seigneurs locaux ne parviennent pas à défendre leurs terres. À la fin du 9ème siècle, Charles le Gros permettra alors la construction de forteresses, incitant les riches à renforcer leurs maisons pour abriter familles, bétail et récoltes lors des invasions. C’est ainsi que les villages commencent à émerger autour des manoirs seigneuriaux.
Division du Vexin
Le duché de Normandie subit des ravages si intenses que les héritiers d’Alexandre, comte du Vexin, n’osent revendiquer sa succession. Le roi Charles le Simple nomme alors son frère Robert à la tête du comté et charge l’archevêque de Rouen de négocier avec le chef normand Rollon. Ce dernier cesse alors ses attaques lorsque le roi lui cède la moitié des terres du Vexin et qu’il prend pour épouse la fille de ce dernier. De nombreux châteaux sont édifiés le long de la rivière frontalière des deux Vexin.
Premier duc de Normandie, Robert se convertit au christianisme et commence à gagner la confiance des habitants. Son fils Guillaume s’intéresse davantage à la chasse et aux plaisirs et est assassiné en 943.
Cette donation menace de rendre Robert, comte du Vexin, furieux. Près de 936, son fils Hugues le Grand prend le trône. Ne désirant pas le pouvoir, il invite Louis, fils de Charles le Simple, à le reprendre. Malgré quelques mariages politiques en 946 entre Richard, le troisième duc de Normandie, et la fille d’Hugues, les conflits demeurent fréquents, jusqu’à la paix établie par le traité de Jeufosse en 968.
Profitant des querelles au sein du Vexin français, Hugues Capet, fils d’Hugues le Grand, réussit à se saisir du trône en 987, puis son fils lui succède en 996. Craignant la fin du monde, de nombreuses personnes abandonnent leurs champs, entraînant une famine. Affamés, beaucoup entrent dans les ordres pour fuir la misère, ce qui amène à la construction de nombreuses abbayes et monastères, financées par des seigneurs locaux pour s’assurer des alliés.
Le duché de Normandie revient à Robert le Magnifique en 1028. À la mort de Robert le Pieux en 1031, la reine cherche à favoriser l’accès au trône de son fils cadet, mais son fils aîné, Henri, fait appel au duc de Normandie pour reprendre son trône, promettant des terres supplémentaires du Vexin. Promptement, le duc, surnommé le « Diable », envahit le Vexin français et marche vers Beauvais. Après avoir éprouvé des remords pour ses actions, il part en pèlerinage à Jérusalem, confiant son fils Guillaume,dit le Bâtard, au roi Henri Ier, avant de mourir en 1035. Durant son absence, les seigneurs locaux cherchent à régler leurs différends.
Vers un Vexin unifié
En 1054, Guillaume grandit et hérite du duché. Après avoir noué des alliances avec les seigneurs du Vexin, il se lance dans la bataille à Hastings en 1066 et remporte la victoire, ce qui le consacre roi d’Angleterre. Établi comme Guillaume le Conquérant, il meurt d’une chute imprévue en 1087, laissant le duché à son fils, le prince Robert Courteheuze. En 1086, Alix, sa petite-fille, s’unit à Hugues de France, le troisième fils du roi, liant ainsi le Vexin normand au royaume de France.
En 1095, les croisades suscitent un engouement parmi de nombreux seigneurs, y compris le duc de Normandie. À son retour, il trouve son frère Henri à la tête de son duché et, refusant de lui restituer sa place, Henri l’enferme et se proclame roi d’Angleterre et duc de Normandie en 1106. Louis VI exprime son mécontentement et déclare la guerre à Henri Ier, entraînant des massacres entre les factions rivales sur tout le territoire.
L’alternance et la chute
En 1147, le roi Louis VII chasse le duc et part en croisade pour expier ses péchés, revenant ruiné en 1149. Henri II, roi d’Angleterre, aspire à reprendre le Vexin. Finalement, les deux souverains se réconcilient en 1160, promettant le mariage de leurs enfants, Henri de Courmantel, 7 ans, et Marguerite de France, 3 ans. Cependant, les querelles se poursuivent, avec la destruction des châteaux et abbayes de l’autre. À la mort d’Henri II, son fils Richard Cœur de Lion, s’entend bien avec Philippe-Auguste, partant ensemble en terre sainte en 1190. À son retour un an plus tard, Richard continue de traquer les infidèles.
Philippe-Auguste en profite pour récupérer Dangu, Gisors et Neaufle. À son retour en 1196, Richard, en difficulté financière, consent à l’abandon du Vexin par le traité de Gaillon. Mais Jean sans Terre, le frère de Richard, furieux, envahit le Vexin pour annuler le traité. Henri réagit, et les combats se poursuivent jusqu’en 1200, lorsque Louis, fils de Philippe-Auguste, s’engage auprès de Blanche de Castille, nièce de Richard. En 1204, Philippe-Auguste expulse Jean du duché.
En 1212, le seigneur Guillaume de la Villetertre dirige le duché et les alentours. Les petits seigneurs, Hugues de Chaumont, Guy V de la Roche, Simon de Neaufle, Jean de Gisors, contribuent à unifier le territoire jusqu’en 1222. St-Louis, couronné roi en 1226, parvient à pacifier les grands seigneurs en 1242, instaurée une paix durable, sans influence anglaise dans la région. Il part en terre sainte en 1248 et revient dix ans plus tard. Philippe le Hardi, son fils, continue le travail de paix et d’harmonisation des pouvoirs.
La revanche des Anglais
Au 14ème siècle, les variations de succession des rois ne perturbent pas la stabilité du Vexin. Après Philippe le Bel, surviennent Louis le Hutin, puis Louis X, Philippe le Long, Charles le Bel, mettant fin à la lignée capétienne en 1328. Le trône revient à Philippe VI, un cousin des Valois. Cependant, Isabelle, fille de Philippe le Bel, devenue reine d’Angleterre, désire voir son fils Édouard III sur le trône de France. En 1346, elle débarque en Normandie, semant destruction sur son passage et marchant vers Paris. La bataille à Crécy entraîne la défaite du roi, et son fils Jean prend le relais, tentant de repousser les Anglais, mais capturé à Poitiers en 1356.
Charles V libère Jean par le traité de Brétigny en 1358. Charles VI confirme ensuite le rattachement du Vexin français à l’Île-de-France, mais est frappé par une insolation en 1392, ce qui le rend fou. Les ducs d’Orléans et de Bourgogne voient cela comme une opportunité pour prendre le royaume. La paix scellée à Pontoise en 1413 entre les Armagnacs et les Bourguignons doit faire face à l’invasion anglaise de la Picardie, aboutissant à un siège de Rouen. Paris capitule en 1420, et le roi anglais Henri V épouse Catherine, la fille de Charles VI.
La libération inattendue
Lorsque Charles VII succède à son père, presque toute la France est aux mains des Anglais. En 1429, il rencontre Jeanne d’Arc à Chinon et lui confie l’organisation de ses armées. Trahie par l’évêque de Beauvais, elle est brûlée vive en 1431, soulevant l’indignation populaire. Les Anglais, semant la terreur, ravagent le Vexin, en saccageant églises et abbayes. En 1435, Charles VII passe à l’action, repousse les Anglais, et libère son Royaume en 1450.
Un Vexin chahuté
Le fils de Charles, Louis XI, gouverne avec fermeté jusqu’en 1483. Les explorations de nouvelles terres apportent des richesses au royaume, profitant à Louis XII. Pour faciliter la transmission des héritages, l’état civil est instauré en 1509, bien que sa généralisation prenne deux siècles. Ces richesses engendrent des avancées dans l’imprimerie, la construction, et le commerce, mais favorisent également de nouveaux délits. François Ier tente de réformer le droit pénal en se penchant sur la « Coutume ». Cependant, l’essor de nouvelles idées religieuses, initiées par Luther et Calvin, crée des divisions.
Malgré la répression, la réforme continue d’avancer. François II établit des bureaux d’inquisition et des bûchers apparaissent. En 1561, nobles et tiers états se rencontrent avec Charles IX et Catherine de Médicis, cherchant à éviter la guerre civile. L’échec des négociations mène au massacre de Vassy en 1562 par le duc de Guise, entraînant le bain de sang de la Saint-Barthélemy en 1572, où Paris se transformé en terreur pendant trois jours, et Charles IX perd derrière cette frénésie de sang le sommeil.
Henri de Guise, connu comme Henri le Balafré, cherchant à s’emparer du trône, fonde la Ligue en 1576. Henri III promet alors de pourchasser les protestants, mais la Ligue l’accuse d’inaction, causant agitation. En 1589, il est assassiné sur un coup d’état, désignant Henri de Navarre comme son successeur. Ce dernier, protestant, libère les huguenots, et avec sa troupe béarnaise, impose sa force, ce qui engendre de nouveaux troubles.
Finalement, en 1593, Henri de Navarre, épuisé, abjure à St-Denis. La paix revenue, il se rend à Gisors avec Gabrielle d’Estrée ; il accepte aussi la démolition du château de Gaillard demandée par les résidents du Vexin. Charles III de Bourbon, archevêque de Rouen, récupère les matériaux pour construire le château de Gaillon. Henri IV échappe à une tentative d’assassinat en 1594, mais malgré ses efforts pour améliorer les conditions de vie, il est finalement assassiné en 1610.
La Fronde et les abus de l’aristocratie
En 1614, Louis XIII monte sur le trône, et l’évêque Richelieu devient ministre des affaires étrangères. En 1642, sa charge est reprise par le cardinal Mazarin. L’avidité montrée par ce dernier irrite la haute noblesse, provoquant la révolte de la Fronde. Les princes de Condé, Conti et Longueville créent le trouble à Paris et en Normandie. Pendant ce temps, en 1655, une crue de la Seine emporte le pont de Meulan, tandis qu’en 1693, une falaise de craie s’effondre, causant la mort de plusieurs habitants. Pendant ce temps, Louis XIV se concentre uniquement sur la construction de son palais de Versailles, et en 1685, il révoque l’édit de Nantes, provoquant ainsi de nouveaux massacres et fuyant les derniers protestants.
Le 18ème siècle est le théâtre de nouvelles tensions religieuses, notamment à l’égard des Jansénistes, qui dénoncent les abus de l’église et de l’aristocratie. La colère monte.
Une vie meilleure en perspective
En 1774, lorsque Louis XVI accède au trône, le pays est à genoux. Les premières révoltes éclatent en 1775 avec le vol de réserves de grain à Meulan. Plutôt que de réformer, le roi se laisse influencer par les courtisans aux ambitions de pouvoir. En soutenant la lutte pour l’émancipation des États-Unis, il s’oppose à l’Angleterre, puis saturé par les conflits, il néglige ses responsabilités en se consacrant à ses plaisirs. Malgré ses convocations à l’aristocratie, aucun ne consent à réduire son train de vie. La situation se dégrade avec un orage de grêle en 1788 qui ravage 1 039 communes, rendant toute production agricole impossible, ce qui entraîne une grande colère populaire.
Dès 1789, le roi convoque les États généraux. Le marquis de Guiry préside la réunion de Chaumont en Vexin pour rédiger un cahier de doléances. Une fois encore, le roi est persuadé par ceux qui tirent profit de soi-disant abus sociaux. Les deux castes privilégiées, exemptes d’impôts et détenant la majorité des terres, lui conseillent d’opposer résistance. Louis XVI essaie de dissoudre les États généraux, mais échoue. Les députés se forment en assemblée nationale, dont le marquis de Gaillon se retire un an plus tard.
L’espoir d’un avenir meilleur
Lorsque le peuple prend d’assaut la Bastille, les aristocrates impliqués fuient et abandonnent le roi. Tous les privilèges sont abolis et le Vexin est redécoupé en trois : l’Oise, l’Eure, et la Seine et Oise. Ainsi, en 1792, ceux qui refusent d’abandonner leurs privilèges, comme le duc de la Rochefoucauld près de Gisors, sont poursuivis et exécutés. De nouveaux leaders émergent sur le champ de bataille, comme le jeune Napoléon Bonaparte, qui saura profiter de cette turbulence.
Heureusement, les destructions de la révolution épargnent miraculeusement les églises et châteaux du Vexin. En outre, l’industrialisation de Paris reste circonscrite aux alentours immédiats de la capitale, préservant ainsi la beauté et la typicité du Vexin. Cette singularité attire les impressionnistes à la fin du 19ème siècle, qui trouvent l’inspiration dans ses paysages lumineux. Le Vexin devient rapidement un site prisé, d’artistes tels que Pissaro à Ennery et Pontoise, Cézanne à Marines, Monet à Vétheuil, sans oublier les talents de Van Gogh, Daubigny, Corot, et Vlaminck à Auvers-sur-Oise. Le charme du Vexin perdure au fil du XXème siècle, attirant les Parisiens en quête de tranquillité, construisant ainsi des résidences secondaires.
Vexin moderne
Le parc naturel
Créé en mai 1995, le parc reprend les contours du Vexin français. Géré par l’Île-de-France, le Val d’Oise et les Yvelines, il regroupe 99 communes et 6 communautés de communes. Son objectif est de favoriser un développement harmonieux qui repose sur la préservation des patrimoines naturels, culturels et architecturaux.
Le Vexin français se distingue par ses paysages variés et ses habitats uniques (coteaux calcaires, marais, forêts…). Ses vallées, tantôt longues et étroites, tantôt larges et fleuries, comme celles de Viosne et du Sausseron, ponctuent ce plateau. Les buttes d’Arthies, de Rosne et de Marines confèrent une silhouette boisée au paysage, ayant conservé leur couverture de sable et de meulière.
Le patrimoine bâti du Vexin français s’illustre également, en contraste avec les châteaux, églises, et domaines agricoles, il est ponctué de croix, moulins, fontaines, pigeonniers et lavoirs qui frappent par leur simplicité.
En 2014, le Vexin français devient le premier Parc naturel régional reconnu « Pays d’art et d’histoire » par le Ministère de la Culture et de la Communication.
Prêt à vivre une aventure dans le Vexin ?…